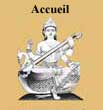Ce site rassemble un certain nombre de textes traduits du sanskrit en français pour permettre à tout un chacun d'en prendre connaissance gratuitement et en lui donnant les informations nécessaires pour les comprendre. C'est pour cela qu'il contient en particulier un "dictionnaire encyclopédique" donnant une explication détaillée de chaque mot ou nom propre:
lexique védique alphabétique
Le principal texte traduit est le Mahābhārata, qui est le grand livre du peuple Bhārata, c'est çà dire du peuple de culture hindoue habitant l'Inde. Mais ce n'est pas uniquement l'épopée fondatrice d'un peuple, à moins de considérer que la Bible est l'épopée du peuple d'Israël. Cette œuvre de quelques 100000 vers rassemble en effet nombre de textes philosophiques et religieux, des prières, des fables et des mythes à portée morale, des informations sur la culture de ce peuple et son organisation sociale, dont des extraits du code civil, qui sont bien souvent toujours d'actualité. La trame conductrice est l'histoire d'une lignée royale, appelés les Kurus ou Kauravas, issue du roi Bharata. Kuru était ce roi, descendant de Bharata, qui le premier laboura la terre et, comme la première partie de la traduction raconte la genèse d'un conflit familial, je l'ai intitulée "les semailles des Kurus": Mahābhārata: les semailles des Kurus La deuxième partie raconte entre autres la grande bataille qui résulta de la discorde que les Kurus avaient semée. Or cette bataille peut être interprétée comme un sacrifice rituel: Mahābhārata: le sacrifice A l'aube de la bataille, Krishna et son disciple Arjuna ont une conversation qui constitue, de l'opinion de nombreuses personnes de toutes confessions religieuses, le plus beau message adressé par Dieu aux hommes. Un enseignement d'une grande bienveillance, dont chacun peut tirer profit indépendamment de l'école religieuse à laquelle il appartient. Un appel à l'union avec le divin, qu'on appelle le yoga, et à la dévotion. Le texte de cette conversation a pour nom "Bhagavad Gītā". Le lien qui suit donne accès au texte sanskrit, sa traduction en français et des commentaires détaillés: Bhagavad Gītā La Gīṭā est ce qu'on appelle en sanskrit un Upanishad (un enseignement aux pieds du maître à penser (le guru). En complément vous pourrez trouver sur cette page la traduction et des notes sur quelques autres Upanishads, les Brahma sūtras et une prière appelée Brahmā samhita. Certains de ces textes sont encore en cours de traduction mais je vous les livre dans leur état inachevé. Brahmā samhita Brahma sūtra anglais
Katha Upanishad